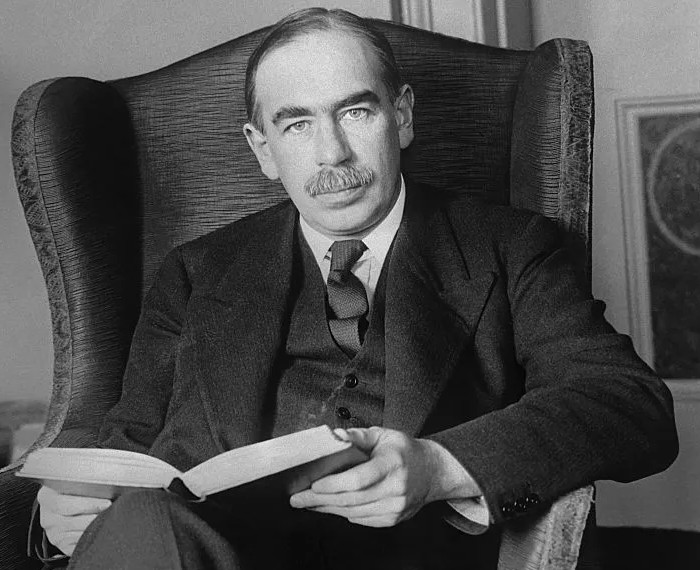LE L I B É R A L I S M E
conception maniaco-bourgeoise de la politique
Pendant long temps le libéralisme a pu se déployer sans trop d’opposition car tout le monde aspirait vers la liberté comme un aimant car il est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels (liberté, sécurité, propriété), au nom d’une vision fondée sur l’individu et la coopération volontaire entre les Hommes. Le système libéral repose donc sur la responsabilité individuelle et le travail ce que tout le monde ne pouvait qu’acquiescer sans autre.
Mais qu’en est-il en réalité ?
Critique du libéralisme, capitalisme total et guerre sociale
Passons en revue les mots même des thuriféraires de cette idée devenue idéologie hégémonique qui a produit le néolibéralisme tant décrié...
 Commençons avec ce papier produit par un ancien président du parti libéral paru dans le 24heures suscitant maintes critiques appuyées...
Commençons avec ce papier produit par un ancien président du parti libéral paru dans le 24heures suscitant maintes critiques appuyées...
Le libéralisme, dépassé? Rien n’est plus faux !
Claude Ruey
Ainsi, à en croire certains («24 heures» du mardi 15 décembre), la pandémie actuelle ferait chanceler l’idéologie «libérale-radicale». Rien n’est plus faux! Croire que la situation extraordinaire d’aujourd’hui mettrait en défaut le libéralisme est totalement inexact !
Que postule en effet le libéralisme? La liberté sous toutes ses formes, que ce soient la liberté d’organiser sa vie, la liberté de faire ses choix personnels, la liberté de pensée et la liberté d’expression, tout comme la liberté économique.
Le libéralisme ne postule pas l’abstention totale de l’État; il lui confère en particulier l’organisation institutionnelle, l’État de droit, permettant précisément la vie en commun dans la paix et l’ordre publics. Et sur le plan économique, tout en postulant la liberté d’entreprendre, il accepte que l’État intervienne pour assurer des mesures de police; ces mesures visent en particulier la santé publique, la bonne foi en affaires ou la paix publique, et forment ainsi les conditions-cadres de l’activité économique.
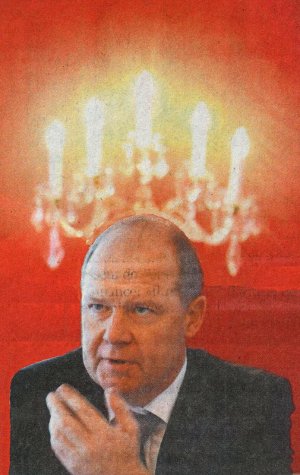 Pour le surplus, l’État doit s’abstenir d’intervenir dans l’économie, mais laisser s’épanouir la concurrence, soit le fait de pouvoir faire valoir ses atouts, d’être créatif, de rechercher les meilleures organisations et les meilleurs créneaux commerciaux, tout en prenant des risques quant au choix de l’activité économique dans laquelle on veut s’engager. L’État n’a alors pas à intervenir sur les choix opérés, sur la détermination des prestations offertes, sur le mode d’organisation des entreprises, car ce sont les acteurs économiques qui dictent leur propre conduite et qui répondent des réussites ou des échecs de leurs choix.
Pour le surplus, l’État doit s’abstenir d’intervenir dans l’économie, mais laisser s’épanouir la concurrence, soit le fait de pouvoir faire valoir ses atouts, d’être créatif, de rechercher les meilleures organisations et les meilleurs créneaux commerciaux, tout en prenant des risques quant au choix de l’activité économique dans laquelle on veut s’engager. L’État n’a alors pas à intervenir sur les choix opérés, sur la détermination des prestations offertes, sur le mode d’organisation des entreprises, car ce sont les acteurs économiques qui dictent leur propre conduite et qui répondent des réussites ou des échecs de leurs choix.
Il en va tout autrement quand on se trouve dans une situation de catastrophe. Dans un tel cas on ne peut pas dire que tel ou tel secteur économique doit s’en sortir par lui-même, lorsqu’il est touché par un événement sur lequel il n’a aucune maîtrise. Dans ces circonstances, ce n’est pas le libéralisme et la concurrence qui ont fait défaut, mais c’est l’état général dans lequel se trouve la société, comme c’est le cas lorsqu’il y a des catastrophes naturelles. Dans une telle situation, il n’y a aucune contradiction à voir des libéraux demander à l’État d’exercer en quelque sorte le rôle de l’assureur général et de veiller à la solidarité nécessaire pour maintenir des structures et des entreprises qui, jusque-là, n’avaient pas eu de problèmes particuliers.
Il en irait tout autrement si on demandait à l’État de soutenir des canards boiteux. En l’occurrence, les aides doivent pouvoir être données aux entreprises victimes de la situation globale et des décisions sanitaires de l’État, pour autant bien sûr qu’on vérifie la viabilité desdites entreprises. Ceux qui verraient une contradiction entre le libéralisme et l’intervention de l’État dans une telle situation n’ont rien compris au libéralisme.
Cl.R.
24heures du 15 décembre 2020 - Point fort
La vie des partis à l'ère covid
Comment la crise sanitaire bouscule le PLR
Cadres, membres et dirigeants du parti traversent des conflits liés aux aides de l’État. Au cœur de l’idéologie libérale-radicale.
Cindy Mendicino
Plus ou moins d’État? Au PLR, la réponse est souvent «moins». Sauf que, depuis le début de la pandémie, et encore plus fortement depuis quelques semaines, des libéraux-radicaux vaudois, encartés ou proches du parti, réclament haut et fort des aides financières étatiques.
 On a ainsi entendu le Centre Patronal, GastroVaud ou la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) attaquer le manque de réactivité des ministres en place, notamment Philippe Leuba et Pascal Broulis. À leur tête ou chez les cadres, des PLR notoires, députés, présidents de section. Même le mouvement de contestation des bistrotiers «Qui va payer l’addition» a été créé par un membre du PLR Lausanne.
On a ainsi entendu le Centre Patronal, GastroVaud ou la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) attaquer le manque de réactivité des ministres en place, notamment Philippe Leuba et Pascal Broulis. À leur tête ou chez les cadres, des PLR notoires, députés, présidents de section. Même le mouvement de contestation des bistrotiers «Qui va payer l’addition» a été créé par un membre du PLR Lausanne.
Argument le plus courant: Vaud est un canton riche, très riche. Notamment grâce à ses entrepreneurs. Il peut et il doit même largement délier les cordons de sa bourse. D’autres, Pascal Broulis en tête, jouent la prudence et veillent au sacro-saint équilibre budgétaire.
Tout cela compose un cocktail explosif qui vient donc remettre sur le tapis de vieilles dissensions idéologiques. Place du travail, rapport aux groupes d’intérêts, étendue de la couverture sociale, recherche de l’équilibre budgétaire
Nous avons demandé à des spécialistes et autres commentateurs politiques d’analyser la situation actuelle.
C.M.
Diverse réponses
NAISSANCE DU NÉOLIBÉRALISME, IDÉOLOGIE DES TEMPS MODERNES
Pierre Guex
«Néolibéralisme»: le terme a été si souvent utilisé qu’il n’évoque plus aux yeux du public que l’appellation semi-savante de «pensée de marché». Comme toutes les idéologies dominantes, celle-ci fait oublier ses origines pour se prétendre éternelle, naturelle. Or, à ses débuts, le néolibéralisme était en fait un courant d’après-guerre marginal, qu’un petit groupe d’évangélistes s’employa ensuite à populariser.
«Un économiste qui est seulement un économiste, explique Friedrich von Hayek en 1956, est susceptible d’être un fléau si ce n’est un réel danger.» Né en 1899 dans une famille de la noblesse viennoise, Hayek incarne le néolibéralisme tout comme John Maynard Keynes personnifie l’interventionnisme. Tous deux partagent une approche pluridisciplinaire de l’économie, une croyance en la toute-puissance des idées et un mépris aristocratique pour les peuples. Ils s’affrontent, et leurs thèses évoluent en opposition de phase : hégémonique au début du XXe siècle, le libéralisme est marginalisé dans le monde occidental en 1944 au profit de l’approche keynésienne.
 Cette année-là, Hayek affirme dans un pamphlet à succès, La Route de la servitude, que toute politique fondée sur la justice sociale et l’interventionnisme mène au nazisme ou au communisme. Pour lui, la société – il déteste ce mot – ne s’articule pas autour des classes sociales ni l’économie autour des grands agrégats* (l’offre, la demande), mais repose sur la rationalité des comportements individuels, qui s’harmonisent dans «l’ordre spontané» du marché.
Cette année-là, Hayek affirme dans un pamphlet à succès, La Route de la servitude, que toute politique fondée sur la justice sociale et l’interventionnisme mène au nazisme ou au communisme. Pour lui, la société – il déteste ce mot – ne s’articule pas autour des classes sociales ni l’économie autour des grands agrégats* (l’offre, la demande), mais repose sur la rationalité des comportements individuels, qui s’harmonisent dans «l’ordre spontané» du marché.
Dans cette conception, l’État joue un rôle non pas de redistribution mais de producteur de services (sécurité, infrastructures, statistiques, revenu minimum) inadéquatement assurés par le marché. Lequel garantit la liberté par la dispersion des pouvoirs. «C’est la soumission de l’homme aux forces impersonnelles du marché qui, dans le passé, a rendu possible le développement d’une civilisation qui sans cela n’aurait pu se développer; c’est par cette soumission quotidienne que nous contribuons à construire quelque chose qui est plus grand que nous ne pouvons le comprendre.» Énoncés au moment où les gouvernements européens bâtissent les systèmes de protection sociale sous la pression populaire, ces principes apparaissent loufoques ou, aux yeux des libéraux, utopiques.
Réunir un petit groupe d’individus convaincus, insensibles aux sirènes du compromis
Mais Hayek est opiniâtre. «D’ordinaire, note-t-il, des idées neuves ne commencent à exercer de l’influence sur l’action politique qu’une génération au moins après avoir été formulées pour la première fois.» Si leur mise en œuvre dépend d’un rapport de forces social et politique favorable, leur dissémination s’organise. En 1938, Hayek avait participé à Paris au colloque Walter Lippmann rassemblant des personnalités soucieuses de refonder la pensée libérale dans un contexte de faillite du libéralisme traditionnel et de succès du dirigisme. Après la guerre, il poursuit une stratégie de conquête intellectuelle qui rappelle celle des bolcheviks : réunir un petit groupe d’individus influents, triés sur le volet, insensibles aux sirènes du compromis et convaincus du succès à long terme d’idées pour le moment impensables.
Influence dans les médias
Ce n’est pas un parti, mais une académie internationale, la Société du Mont-Pèlerin, que fonde Hayek en 1947. Puis un think tank britannique, l’Institute of Economic Affairs, créé en 1955 alors que, parti aux États-Unis, il enseigne à Chicago. «Notre but, explique-t-il, n’est pas de trouver une solution permettant de gagner un soutien de masse en faveur d’un programme politique donné, mais au contraire de nous assurer le soutien des meilleurs esprits.»
Aux États-Unis, les idées de Hayek influencent directement les politiques antisociales de l’acteur devenu président Ronald Reagan. Face à cette offensive, Jesse Jackson, candidat noir malheureux aux primaires démocrates de 1984 et 1988, fait campagne pour une couverture sociale universelle et une hausse d’impôts pour les riches. Des mesures que le candidat démocrate victorieux n’osera pas reprendre à son compte.
En cela la tâche des néolibéraux s’avère moins ardue que celle des communistes : il ne s’agit pas de renverser l’ordre économique, qui repose toujours sur la propriété privée, mais d’en corriger l’inflexion sociale-démocrate. La feuille de route exposée par Hayek en 1960 dans La Constitution de la liberté, et résumée par l’économiste Gilles Dostaler, n’en reste pas moins ambitieuse pour l’époque : «déréglementer, privatiser, réduire et simplifier les programmes de sécurité sociale, diminuer la protection contre le chômage, supprimer les programmes de subvention au logement et les contrôles des loyers, abolir les programmes de contrôle des prix et de la production dans l’agriculture, réduire le pouvoir syndical».
Ses idées infusent dans la presse, les universités, la haute fonction publique, le patronat. Au milieu des années 1970, l’essoufflement du compromis social d’après-guerre lui fournit un terrain favorable. Hayek reçoit le «prix Nobel» (lire «Quand une banque distribue des médailles») d’économie en 1974 et, l’année suivante, une jeune dirigeante du Parti conservateur britannique nommée Margaret Thatcher brandit l’un de ses livres lors d’un débat en expliquant : «Ça, c’est ce que nous croyons.»
L’hégémonie de la Chine
De plus le village global et l’hégémonie de la Chine dans le domaine de la production. Elle est devenue l’atelier du monde rendant caduque les explications classiques d’ un capitalisme autorégulateur détaché de l’État... En effet, des pans entiers de l’industrie se sont effondrés en Europe avant même le covid. Où fabrique t’on encore en Europe des ordinateurs, des radios, des fours à micro ondes des éoliennes, etc. C’est le keynésianisme (même les libéraux n’osent plus dire moins d’État) qui est de retour et malheureusement c’est là où il est, pour l’instant le plus autoritaire, c’est-à-dire en Chine, qui sur le plan économique donne les meilleurs résultats.
Je ne crois pas que dans la logique politique actuelle de l’UE on pourra rapatrier la production où alors de manière très marginale. Quant à la dette des États qui augmente de manière dramatique en Europe par le quantitative easing. je n’ai aucune certitude sur ce processus consistant à faire tourner la planche à billets. Certains imaginent qu’il faudra la rembourser dans un délai de quelques années. D’autre pensent que l’on pourra geler cette dette pour une période de 100 ans tout en la faisant apparaître au bilan des banques centrales et continuer à faire fonctionner la planche à billets par ces institutions.
Il y a cependant beaucoup de raisons d’ être inquiet car à ma connaissance, dans l’histoire du capitalisme, souvent quand on a utilisé ce processus cela a mal tourné. Bref le néolibéralisme est entrain de tuer le libéralisme même si depuis la Suisse, on voit souvent les faits avec un miroir déformant.
Problème de société
Le système capitaliste, dont la base incontestable est le libéralisme, impose aux gens d’en bas une situation de déni, de souffrance et d’insécurité sociale. Libéralisme conduit à une barbarisation des rapports sociaux. Entre la politique effectivement menée par les libéraux et certaines aspirations de la base populaire de la société, il existe une situation de tension permanente. Elle peut provoquer des déchirements importants. Pour juguler ces tensions sur les questions sociales que soulèvent ses intérêts immédiats et concrets, les libéraux doivent produire des dérivatifs puissants notamment par le biais de l’économie. Cela la pousse à radicaliser ses opérations sur l’énomie et son tissu. Elle doit aussi renforcer sa proposition politique générale: mainmise sur état, lobbyisme intense, liquidation des conquêtes et des protections sociales, saccage des politiques et des mécanismes de redistribution, démantèlement du service public.
La politique générale du libéralisme est inséparable d’une exigence de soumission et de conformisme généralisé.
- - - - - - - -
Quand le libéralisme est devenu un dogme
Georges Tafelmacher
Selon M. Claude Ruey, le libéralisme n’est pas prêt à disparaître ni à se faire dépasser.
Or, le problème n’est pas le libéralisme en tant que tel mais le fait qu’il est devenu une idéologie hégémonique où l’économie aura pris le pas sur tous les autres facteurs sociaux. De plus, le libéralisme n’a pas le monopole du cœur, ni celui de la liberté, ni celui de la responsabilité individuelle, comme si ce seraient des «valeurs» de droite, reléguant la Gauche à n’être que des adorateurs de l’État. La plupart des partis politiques, dont les Socialistes, ont à leurs frontons la responsabilité individuelle comme valeur mais associée à la nécessité d’un «vivre-ensemble» citoyen où chacun aurait son mot, sa voix et sa voie.
Le problème n’est pas le libéralisme mais ce que certains en ont fait, réduisant la population à des acteurs par trop influencés par l’économie de la consommation érigée en dogme absolu. Ce libéralisme là a permis l’avènement des plus forts, des plus intrigants, des plus entreprenants où le simple quidam n’a d’autres mots à dire que de courber l’échine et d’accepter ce qu’on lui donne en pâture.
Le libéralisme, dans sa forme actuelle, doit être dépassé et être remplacé par un véritable engagement citoyen où les habitants seraient directement responsables du développement de ses rues, de ses quartiers et, au final, de ses villes par la tenue d’associations de quartier, où les entreprises seraient aux mains de ses ouvriers en autogestion, où la participation et la collaboration auront pris le pas sur cette concurrence acharnée qui sévit depuis bien trop longtemps et qui a marqué de son sceau infâme la société dans son entier.
GPT
- - - - - - - -
On se fourvoie de voie...!
Le libéralisme a engendré le néolibéralisme, ce sont les deux faces d’une même médaille.
De plus, contrairement à ce qu’avance notre interlocuteur, l’État a toujours su utiliser le libéralisme (spécialement dans sa version idéologique) pour assurer son contrôle social et son hégémonie et cela se voit notamment en Chine ou même les USA (et surtout ici chez "nous") où les deux sont tellement imbriqués l’un dans l’autre qu’ils se nourrissent mutuellement. Malgré le fait que l’ex-président tRump aurait tout fait pour lutter contre le "deep-state" et qu’ici la démocratie soi-disant "populaire" serait la "règle", c’est quand cette conjoncture qui prédomine !
Il serait temps de s’en sortir de cette conjonction et de commencer à mener une politique citoyenne où chaque personne de chaque quartier participerait activement à l’essor de celui-ci, où chaque usine serait dans les mains de ses ouvriers travaillant ensembles en autogestion, où la finance ne serait que l’huile qui faciliterait les échanges, où la spéculation sous toutes ses formes – spécialement celle de la spéculation immobilière – serait proscrite...
Mais là, évidemment, je rêve tellement les forces libérales ont pris le pouvoir et ont leurs thuriféraires patentés trop bien écoutés par leurs adeptes formatés...
GPT
- - - - - - - -
Point fort - Oscar Mazzoleni
«Le PLR est face à un changement rapide et inattendu des demandes de sa base»
C’est dans le rapport à leur électorat qu’Oscar Mazzoleni identifie une partie des problèmes actuels des libéraux-radicaux. Le politologue de l’Université de Lausanne remarque que «les demandes de la base ont subitement et brutalement changé». Le spécialiste souligne néanmoins que tous les partis sont face à une problématique similaire. «L’interventionnisme étatique est devenu un enjeu pour tous et à tous les niveaux institutionnels.»
Problème pour la droite: la pandémie tend à créer des demandes pour davantage d’interventionnisme, ce dont elle se méfie fortement d’ordinaire. «Le PLR est dans cette tension entre la nécessité de garder des finances publiques aussi saines que possibles (un de ses piliers) et l’urgence d’investir dans l’économie. Celle-ci étant notamment formulée par les petits entrepreneurs.»
En Suisse, rappelle Oscar Mazzoleni, «la politique fonctionne avec le principe, largement dominant, qu’il faut laisser faire le marché. Et dans l’optique libérale, tu payes si ce qui t’arrive est de ta faute. Mais en ce moment, même pour nombre de libéraux, l’entrepreneur n’est pas responsable de la crise et donc ne devrait pas payer tout seul.»
Le spectre de la dette
De leur côté, les dirigeants doivent sans cesse veiller à «à la fois ne pas donner raison à la gauche et ne pas se retrouver dans une situation intenable avec leurs électeurs». À terme, au-delà de la crise, pointe la question de la dette qu’elle engendrera. Qui devra la payer? «La gauche reste assez silencieuse sur tout ça, parce qu’elle sait, au fond, que ce sont les prestations sociales qui en pâtiront. Et pas une modification de la fiscalité, puisque la droite ne la voudra pas.»
Le cas vaudois est pour le professeur encore plus compliqué: «Il est ici plus difficile d’accepter des limitations dans les aides, puisque le canton est riche. Sauf que les ministres de droite restent sur l’idée qu’il faut somme toute épargner pour le futur.»
D’ailleurs, dit-il, l’écart se creuse tous les jours un peu plus: «C’est un hiatus entre d’un côté les dirigeants à la réflexion à moyen terme et de l’autre les entrepreneurs avec leurs problèmes de survie à court terme.» Entre eux: les «relais fragiles», comme les appelle Oscar Mazzoleni. On a vu les réactions des dirigeants de faîtières professionnelles s’énervant contre leur ministre des Finances Pascal Broulis. «Les relais, d’ordinaire alliés, fonctionnent-ils encore? La crise semble révéler que cela ne va plus de soi.»
- - - - - - - -
Point fort - Olivier Meuwly
«Toutes les contradictions qui fondent les libéraux-radicaux sont sur la table»
L’historien Olivier Meuwly est «membre coopté de la direction» du PLR, dit le site internet du parti. Grand spécialiste, donc, mais aussi partie intégrante de cette organisation secouée par la crise. Lui admet en tout cas qu’une pression s’exerce sur les principes de base de son parti. «Mais la pandémie a plutôt démultiplié des débats internes déjà à l’œuvre, par exemple via les questions écologiques.»
Ainsi, pour Olivier Meuwly, «le libéralisme et le PLR de façon générale se légitiment dans leur délicat contrat dialectique entre liberté et État. L’État est toujours reconnu comme un acteur naturel du jeu. Reste encore à définir son périmètre d’action. Le PLR met un point d’honneur à dépasser ce type de contradictions. En ce moment, il est servi!»
Il voit en filigrane la nécessité pour l’État d’anticiper les problèmes. «Mais à quel point? Le PLR estime qu’il faut rester vigilant et éviter les excès de dépenses.» Pour lui, les contradictions actuelles n’ont «pour l’instant pas la force d’aiguiser trop les conflits latents. Mais si la crise dure».
Rupture classique
Olivier Meuwly souligne aussi que la rupture entre membres du gouvernement et le reste du parti est un classique chez les libéraux et ne s’en émeut donc que modérément. «Chez les radicaux, c’est différent. La base a une compréhension du rôle de l’État qui est plus forte Mais il est clair qu’il ne fait pas bon être dirigeant et PLR en ce moment.»
La couture entre les deux ailes du parti vaudois, réunies sous l’appellation PLR depuis 2012, pourrait-elle lâcher? Olivier Meuwly n’y croit pas, lui qui estime que la fusion est totale et qu’il n’existe plus deux tendances distinctes.
«En revanche, la position du parti sur le libéralisme pourrait évoluer. Les questions seront: doit-on laisser faire l’économie tout le temps, intervenir mais dans un deuxième temps, ou s’inventer investisseur? Il faudra aussi clairement trancher, dans l’immédiat: les gens veulent-ils des aides ou veulent-ils pouvoir travailler? Ça n’est pas pareil. Une aide financière, ce n’est pas gagner de l’argent.»
Selon Olivier Meuwly, la droite pousse à calculer jusqu’à quel point la situation sanitaire peut priver de liberté autant de monde. «Compte tenu des risques à plus long terme sur les finances, peut-être que des demandes plus fortes se feront entendre pour que les précautions sanitaires passent au second plan.»
- - - - - - - -
Point fort - René Knüsel
«C’est la question de l’État social et du rapport des libéraux avec le travail qui est à l’œuvre»
«Il y a matière à tension», assure René Knüsel. Le politologue estime que le PLR se confronte actuellement «à la limite de son cadre idéologique».
La source du problème est dans l’étendue de la couverture sociale suisse, dit-il. «On n’a pas souhaité qu’elle s’étende aux personnes qui sont leur propre chef. Les indépendants ou les patrons. L’État est dès lors celui qui se substitue entre le donneur et le receveur d’emploi. Et cette couverture touche donc les ouvriers et les salariés de façon générale. Le petit chef d’entreprise n’entre pas dans ce cadre.»
Le travail, alpha et oméga
Au cœur, poursuit René Knüsel, se situe le rapport au travail. «C’est lui qui offre la protection, c’est à partir de là que sont calculées les prestations dont on peut bénéficier. En prélevant de l’argent sur les salaires.» La tension naît dès lors que le travail n’est plus possible. Les mots de Christophe Reymond, directeur du Centre Patronal, à l’égard de l’État et du ministre PLR des Finances l’ont frappé: «Il dit: «L’État doit assumer sa responsabilité.» Je le comprends! Sauf que la droite se retrouve à demander quelque chose qu’elle a toujours refusé.»
Le patronat découvre-t-il les risques inhérents à sa position? «Non, parce que les indépendants et les patrons connaissent et acceptent les risques courants. Mais, là, ils ne peuvent rien faire: pour la santé des gens, des activités ont été interdites. On est en train de découvrir que la liberté d’entreprendre, si centrale en Suisse, peut s’arrêter. Cette privation pose tellement de problèmes que les libéraux oublient qu’ils prônent sans cesse la liberté individuelle. C’est à mon sens la révélation d’une pensée politique qui ne serait pas totalement aboutie.»
Dans le rapport qu’entretient la base avec Pascal Broulis, René Knüsel observe «une sacrée maîtrise» du grand argentier. «Il maintient un cap et appelle à la responsabilité de chacun. En face, on lui dit: il y a des réserves, il faut les utiliser! Lui tient et répond qu’il aidera ceux qui décrochent vraiment quand ils pourront de nouveau être actifs.»
La crise actuelle fera sans doute évoluer des idées plus que des personnes, prédit le politologue. «La perception de certains modèles va changer. Peut-être que quelque chose comme le revenu de base universel, qui n’est certes pas la panacée, offrira un bout de réponse.»
René Knüsel voit aussi un constat implacable. «Ce que nous croyions indestructible, notre sécurité, est en réalité très fragile. C’est une leçon de vulnérabilité qui, si elle est comprise, sera très utile pour l’avenir.»
- - - - - - - -
Letrre de lecteur - 24heures du 11 janvier 2021
Les seigneurs du tout économique
À propos de la Réflexion de M. Claude Ruey intitulée «Le libéralisme, dépassé? Rien n’est plus faux!» («24 heures» du 17 décembre 2020).
Mais où sont-ils les chantres du libéralisme et du moins d’État? Les zélés concepteurs des duperies et allègements fiscaux pour les plus riches ont-ils disparu? Nous l’entendons moins, notre puissante et outrancière aile droite bourgeoise jamais disposée à engager sa propre solidarité matérielle.
Rassurez-vous ils sont encore là, mais aujourd’hui et sans états d’âme ces mêmes grands partisans de l’État exsangue sollicitent par milliards l’aide étatique destinée aux multiples victimes de leur économie, mise à mal par un microscopique virus. Seul survivant bourgeois osant encore s’exprimer: Claude Ruey le valeureux invité de «24 heures» qui nous propose son exaltante poésie pour le grand libéralisme, seule doctrine selon lui, permettant la liberté sous toutes ses formes on en découvre déjà les lourdes séquelles.
À l’évidence, nous en sommes tous conscients: des aides financières colossales doivent être libérées pour porter secours aux plus démunis, chômeurs, salariés, artistes, indépendants, PME. Mais rappelons aussi qu’en ces temps difficiles, pendant que des entreprises perdent pied et risquent la faillite, d’autres réalisent des profits records en cette année 2020. Ne serait-ce pour l’exemple: la famille Blocher a augmenté son capital de deux milliards en cette année bénie pour certains.
En bref: seule une nouvelle et future conception de la fiscalité permettra un jour une véritable solidarité ainsi qu’une plus juste répartition des aides et des charges sans surendetter uniquement Confédération, Cantons et Communes.
Jean-Frédéric Mayor, Chigny
- - - - - - - -
Letrre de lecteur - 24heures du 11 janvier 2021
Défendre le bien commun
À propos de la Réflexion de M. Claude Ruey intitulée «Le libéralisme, dépassé? Rien n’est plus faux!» («24 heures» du 17 décembre 2020).
Dans son plaidoyer pour le libéralisme, M. Ruey oublie de préciser que dans bien des cas, c’est précisément la doctrine néolibérale qui amène la société à des crises d’une ampleur sans précédent. Citons pour exemples la crise financière dite des subprimes qui dans les années 2000 a précipité des millions de particuliers et des États dans la misère, la crise climatique et plus globalement écologique qui menace une grande partie de la vie sur terre. Dans ces deux cas, il est clair que l’arrogance et l’aveuglement d’une certaine classe politique conservatrice dont M. Ruey a appliqué les dogmes au gouvernement vaudois sont directement responsables de ces méfaits.
Sans contester la justesse de la libre entreprise, il est plus que temps de laisser aux ONG et aux États les coudées franches pour défendre le bien commun que les intérêts privés surexploitent et détruisent dans le cadre du pur et dur libéralisme économique.
Philippe Junod, Romanel-sur-Morges
- - - - - - - -
Gregoire Jotterand
Merci pour cette précieuse mise au point. Je partage l’idée d’un libéralisme "social" – je ne sais pas si cet adjectif vous convient.
Il importe à mon sens de défendre cet esprit libéral remis en question par la financiarisation de l’économie et de l’industrie en particulier, de la privatisation à outrance de tâches étatiques et par les excès de l’idéologie du moins d’État. Je pense que le PLR gagnerait en caractère en se distinguant clairement sur ces points de l’UDC. (voir ci-dessous le chapitre consacré)
- - - - - - - -
Lettre de lecteur - 24heures du 27 janvier 2021
Au temps de la pandémie
En réponse à Claude Ruey, l’avocat dogmatique de fariboles consuméristes et sa lettre du 24heures du 17 décembre 2020
La doctrine que je dénonce ici reste avant tout une puissante machine de pouvoir destinée à gagner les élections. Derrière les cousins UDC, les libéraux-radicaux ont beaucoup critiqué les mesures sanitaires de l’Exécutif, pourtant incarné au Conseil fédéral par une majorité bourgeoise.
Le 17 décembre passé, sous la plume de Claude Ruey l’avocat dogmatique de fariboles consuméristes, j’ai pu lire amusé qu’un microscopique virus a métamorphosé sa thèse selon laquelle l’État n’est là que pour assurer généreusement des conditions-cadres visant à permettre à l’économie de s’épanouir sans entraves.
L’ancien président du Parti libéral suisse invoque la situation de catastrophe allant à ses yeux jusqu’à justifier l’aide de l’État. Mais seulement, bien sûr, pour sauver les entreprises saines... Donc attendre simplement qu’un entrepreneur – souvent PLR – crie famine avant de le déclarer inéligible aux aides régaliennes pour cause d’imminence de la mort clinique de son affaire semble être le pervers stratagème proposé par le chantre du libéralisme décomplexé.
Il est piquant de constater que ceux qui tirent le frein aux aides de l’État sont aussi prompts à contester son impôt. En définitive, les péripéties économiques actuelles donnent raison à tous ceux qui appellent les électeurs à soutenir dès 2023 les forces responsables pour lesquelles le terme «solidarité» a gardé toute sa signification.
Jean Marzon, Cheyres
- - - - - - - -
Marc Bertholet - dans le "fb" du 27 janvier 2021
Le Capitalisme
«Nous prouverons que le terroir n’est à personne, mais qu’il est à tous.»
«Nous prouverons que tout ce qu’un individu en accapare au-delà de ce qui peut le nourrir, est un vol social.
Nous prouverons que tout ce qu’un membre du corps social a au-dessus de la suffisance de ses besoins de toute espèce et de tous les jours est le résultat d’une spoliation de sa propriété naturelle individuelle, faites par les accapareurs des biens communs.
Que, par la même conséquence, tout ce qu’un membre du corps social a au-dessus de la suffisance de ses besoins de toute espèce et de tous les jours est le résultat d’un vol fait aux autres co-associés, qui en prive nécessairement un nombre plus ou moins grand de sa quote-part dans les biens communs.»
- - - - - - - -
Dominique Michel - dans le "fb" du 28 janvier 2021
Le Kapital
Le Kapital n’est qu’un outil économique, celui de la société industrielle qui nique la planète et nous asservit.
Depuis le temps, on aurait pu espérer que les productivistes le comprennent mais ils semblent juste trop aliénés par la hiérarchie de leur mode de production pour cela, une hiérarchie qui, de l’enfant esclave à l’actionnaire, renforce les hiérarchies basées sur le pouvoir et la richesse.
De plus, le capitalisme est un excellent outil économique car il est imbattable sur son terrain, la société industrielle, ce qui lui donne une faculté inouïe pour récupérer et travestir à son profit toute contestation qui ne mettrait qu’un ongle dans ses rouages. C’est donc le point fort de l’ennemi.
Les luddites l’avaient bien compris lorsqu’ils sabotaient l’outil de production. La royauté aussi qui a encouragé les syndicats afin de diviser le peuple. La suite on connaît : avec 60% du vivant exterminé à jamais, le mode de production industriel est dans la phase terminale de sa solution finale par extermination de la Vie et cette catastrophe continue d’accélérer avec chaque nouvelle technique industrielle.
- - - - - - - -
Georges Tafelmacher
Ce qui me chagrine le plus avec cette pandémie c’est que la consommation en est sortie renforcée alors que c’est l’assujettissement servile à cette consommation devenue dogme totalitaire qui fait problème...
De nos jours, on consomme de tout depuis les pistes de ski jusqu’aux produits de consommation fabriqués par l’automatisation industrielle pilotée par la numérisation de la production...
Tant que nous ne retrouvons pas la magie de la fabrication d’objets par la main de l’homme et la jouissance directe de ce qui nous entoure, nous ne sortirons jamais du cirque infernal du profit, le totalitarisme de nos temps...
- - - - - - - -
Pierre Guex - dans "fb" du 29 janvier 2021
NAISSANCE DU NÉOLIBERALISME, IDÉOLOGIE DES TEMPS MODERNES
«Néolibéralisme» : le terme a été si souvent utilisé qu’il n’évoque plus aux yeux du public que l’appellation semi-savante de «pensée de marché». Comme toutes les idéologies dominantes, celle-ci fait oublier ses origines pour se prétendre éternelle, naturelle. Or, à ses débuts, le néolibéralisme était en fait un courant d’après-guerre marginal, qu’un petit groupe d’évangélistes s’employa ensuite à populariser.
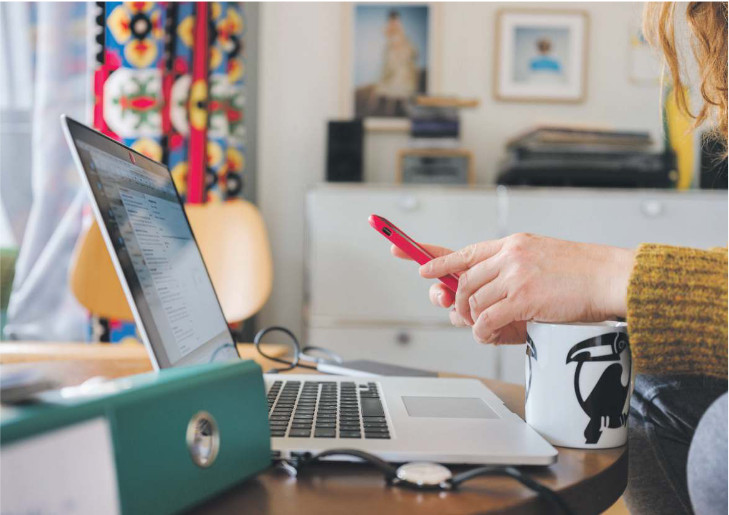
«Un économiste qui est seulement un économiste, explique Friedrich von Hayek en 1956, est susceptible d’être un fléau si ce n’est un réel danger.» Né en 1899 dans une famille de la noblesse viennoise, Hayek incarne le néolibéralisme tout comme John Maynard Keynes personnifie l’interventionnisme. Tous deux partagent une approche pluridisciplinaire de l’économie, une croyance en la toute-puissance des idées et un mépris aristocratique pour les peuples. Ils s’affrontent, et leurs thèses évoluent en opposition de phase : hégémonique au début du XXe siècle, le libéralisme est marginalisé dans le monde occidental en 1944 au profit de l’approche keynésienne.
Cette année-là, Hayek affirme dans un pamphlet à succès, La Route de la servitude, que toute politique fondée sur la justice sociale et l’interventionnisme mène au nazisme ou au communisme. Pour lui, la société – il déteste ce mot – ne s’articule pas autour des classes sociales ni l’économie autour des grands agrégats* (l’offre, la demande), mais repose sur la rationalité des comportements individuels, qui s’harmonisent dans l’«ordre spontané» du marché.
Dans cette conception, l’État joue un rôle non pas de redistribution mais de producteur de services (sécurité, infrastructures, statistiques, revenu minimum) inadéquatement assurés par le marché. Lequel garantit la liberté par la dispersion des pouvoirs. «C’est la soumission de l’homme aux forces impersonnelles du marché qui, dans le passé, a rendu possible le développement d’une civilisation qui sans cela n’aurait pu se développer; c’est par cette soumission quotidienne que nous contribuons à construire quelque chose qui est plus grand que nous ne pouvons le comprendre.» Énoncés au moment où les gouvernements européens bâtissent les systèmes de protection sociale sous la pression populaire, ces principes apparaissent loufoques ou, aux yeux des libéraux, utopiques.
Réunir un petit groupe d’individus convaincus, insensibles aux sirènes du compromis Mais Hayek est opiniâtre. «D’ordinaire, note-t-il, des idées neuves ne commencent à exercer de l’influence sur l’action politique qu’une génération au moins après avoir été formulées pour la première fois.» Si leur mise en œuvre dépend d’un rapport de forces social et politique favorable, leur dissémination s’organise. En 1938, Hayek avait participé à Paris au colloque Walter Lippmann rassemblant des personnalités soucieuses de refonder la pensée libérale dans un contexte de faillite du libéralisme traditionnel et de succès du dirigisme. Après la guerre, il poursuit une stratégie de conquête intellectuelle qui rappelle celle des bolcheviks: réunir un petit groupe d’individus influents, triés sur le volet, insensibles aux sirènes du compromis et convaincus du succès à long terme d’idées pour le moment impensables.
Influence dans les médias
Ce n’est pas un parti, mais une académie internationale, la Société du Mont-Pèlerin, que fonde Hayek en 1947. Puis un think tank britannique, l’Institute of Economic Affairs, créé en 1955 alors que, parti aux États-Unis, il enseigne à Chicago. «Notre but, explique-t-il, n’est pas de trouver une solution permettant de gagner un soutien de masse en faveur d’un programme politique donné, mais au contraire de nous assurer le soutien des meilleurs esprits.»
Aux États-Unis, les idées de Hayek influencent directement les politiques antisociales de l’acteur devenu président Ronald Reagan. Face à cette offensive, Jesse Jackson, candidat noir malheureux aux primaires démocrates de 1984 et 1988, fait campagne pour une couverture sociale universelle et une hausse d’impôts pour les riches. Des mesures que le candidat démocrate victorieux n’osera pas reprendre à son compte.
En cela la tâche des néolibéraux s’avère moins ardue que celle des communistes : il ne s’agit pas de renverser l’ordre économique, qui repose toujours sur la propriété privée, mais d’en corriger l’inflexion sociale-démocrate. La feuille de route exposée par Hayek en 1960 dans La Constitution de la liberté, et résumée par l’économiste Gilles Dostaler, n’en reste pas moins ambitieuse pour l’époque : «déréglementer, privatiser, réduire et simplifier les programmes de sécurité sociale, diminuer la protection contre le chômage, supprimer les programmes de subvention au logement et les contrôles des loyers, abolir les programmes de contrôle des prix et de la production dans l’agriculture, réduire le pouvoir syndical».
Ses idées infusent dans la presse, les universités, la haute fonction publique, le patronat. Au milieu des années 1970, l’essoufflement du compromis social d’après-guerre lui fournit un terrain favorable. Hayek reçoit le «prix Nobel» (lire «Quand une banque distribue des médailles») d’économie en 1974 et, l’année suivante, une jeune dirigeante du Parti conservateur britannique nommée Margaret Thatcher brandit l’un de ses livres lors d’un débat en expliquant : «Ça, c’est ce que nous croyons.»
- - - - - - - -
Le Courrier du jeudi 28 janvier 2021
AGORA
Rationalité néolibérale et «vie bonne»
Société • Le modèle néolibéral ne peut répondre aux catastrophes climatiques et sociales en cours. Une alternative consiste à centrer son action dans ce qui est à la fois immédiat, personnel et social. Point de vue.
MIGUEL D. NORAMBUENA * Consultant psychosocial indépendant
Il n’y a désormais plus de doute: le néolibéralisme actuel ne peut pas être la réponse aux méfaits capitalocènes qui frappent la planète. Ni lui, ni le libéralisme classique d’Adam Smith ne peuvent répondre aux catastrophes climatiques et sociales en cours dont la pauvreté, les pandémies, l’exponentielle déforestation et le bétonnage des villes, la disqualification des métiers, le racisme, l’abandon des migrants, l’individualisme, le machisme et l’émiettement du lien social.

Attention, le néolibéralisme économique qui émerge dans les quatre coins du monde n’est pas une lubie de quelques enfants gâtés des Gafam, accros des logarithmes ou mordus du post-humanisme. Il s’agit bien de la promotion d’une nouvelle rationalité économique. C’est une sournoise révolution des mentalités, chère à notre modernité contemporaine. Wendy Brown parle d’une démocratie devenue néo-libérale.
Ainsi, il impose à chacun·e la responsabilité de sa condition, en dépolitisant la reproduction des inégalités sociales. Chaque sujet devient un appât en quête de valorisation et d’investissement de son porte-feuille (Wendy Brown, 2017/2018). Chaque personne doit travailler son profil, son curriculum vitaeou son «capital» humain, afin d’attirer les bonnes grâces des investisseurs et obtenir des crédits (Silvia Gil, 2018).
Toutes les gouvernances de cette nouvelle «démocratie néolibérale» sont dirigées, non pas par des professionnels intéressés et motivés par l’approfondissement et l’enrichissement des connaissances, mais par une nouvelle technocratie. Ces corps de technocrates, de droite comme de gauche, s’inscrivent dans un managering capitaliste, eux-mêmes cotés par des «agences de notation». Cette gestion tentaculaire dépasse le champ purement économique et capture toute la vie et la subjectivité de chacun·e (Wendy Bown, 2018). Ce vaste appareil de capture est subtilement élaboré et engloutit toute manifestation du socius en modélisant finement l’espace public, professionnel et privé. Les marchés sont mis en exergue au mépris de la vie (Silvia GIL, 2018). Les possibilités de s’en échapper et de forger des alternatives concrètes sont bien maigres.
Pourtant, d’ores et déjà, deux dimensions éthico-politiques demeurent possibles. La première, plutôt collective, récupère et à s’approprie l’espace politique en créant diverses «agences de notation alternatives». Ainsi, «les investisseurs confrontés à une campagne mettant en lumière les entorses à ces valeurs peuvent être amenés à réorienter leurs capitaux, non pas par souci éthique, mais parce qu’ils craignent d’y perdre de l’argent» (Michel Feher, 2017). La deuxième propose une résistance subjective en centrant son action dans ce qui est à la fois immédiat, personnel et social. Elle redirige la créativité et les ressources de chacun·e vers le soin (to care) de la vie au quotidien. Il s’agit ainsi de se donner les moyens d’accéder à une «vie bonne», en prenant soin de la qualité existentielle de son quotidien, avec sa singularité.
Pour (re)découvrir l’élémentaire, il faudrait cesser de courir derrière les crédits et les bonnes notations, mais aussi débrancher internet et le téléphone portable durant les heures de repas et durant la nuit, ou encore allumer la télévision uniquement pour des émissions ciblées. Et, pourquoi pas, écrire son opinion dans les journaux, faire une activité manuelle, tisser des nouveaux liens et créer vos collectifs.
Ce plan de résistance immanent, au cœur du «trouble» (Donna Haraway, 2016/2020), des «ruines» (Anna Tsing, 2020) et de l’exploitation néo-libérale de l’expérience de chacun·e, permet de créer des «espaces inventés» par des pratiques résistantes quotidiennes créatrices. Ces pratiques sont à la portée de chacun·e. Elles permettent de forger des nouvelles espérances et joies de vivre plurielles vers un renouveau démocratique, polyphonique, social, politique, associatif et institutionnel.
MDN
- - - - - - - -
24heures du mardi 15 décembre 2020
La planète brûle
Pas un jour sans qu’une catastrophe se produise dans le monde. Cette terre où nous vivons est en souffrance; atteinte par le productivisme débridé et sans fin. L’humanité et le monde des vivants sont à la peine. De trépidations en trépidations, le mal s’accroît: par des canicules à répétition, par des extinctions de masses, par des océans saturés de plastique, par la destruction des poumons verts que sont les forêts primaires. Mais la liste doit s’arrêter là, car elle est loin d’être terminée.
Nous avons besoin, d’une planète où il fait bon vivre pour toutes les espèces. Notre oxygène est vital, notre eau doit être buvable. L’économie de marché connaît nos besoins pour mieux les exploiter. Le dieu marché a colonisé les esprits; les lois du marché ne connaissent pas d’autres lois que celles de la concurrence et du profit. Le marché est devenu un dogme religieux, où il n’y a pas d’autre solution. Tout se joue dans les bourses, cela montre l’opacité du fonctionnement des marchés financiers, qui sont devenus des casinos à l’échelle planétaire.
De cela, on pourrait croire que nos vies sont devenues des variables d’ajustement structurelles. Ainsi il est facile de penser que le monde économique joue à la roulette russe avec la nature et nos vies. Cela doit changer, pendant qu’il est encore temps. Mais de temps nous n’en n’avons plus beaucoup, il ne faut pas se résigner face à l’adversité. L’humanité dans son histoire a dû faire face à de nombreux périls, qu’elle a pu surmonter. La lutte pour une cause juste entretien l’espoir d’un changement bénéfique pour tous.
Thierry Cortat, Delémont
«Quand les États auront disparu, l’unité vivante, féconde, bienfaisante, tant des régions que des nations, et de l’internationalité du monde civilisé d’abord, puis de tous les peuples de la terre, par la voie de la libre fédération et de l’organisation de bas en haut, se développera dans toute sa majesté.» Bakounine |

La course vers l’abîme
Sur ce, régardons de plus près...
...ce qu’est cette UDC...
La clé de la victoire de l’UDC
L’INVITÉ 24 Heures | 16 Octobre 2007 |
ERIK VERKOOYEN, ÉCRIVAIN ET COLLABORATEUR UNIVERSITAIRE
«À force d’abuser de mots comme racisme ou xénophobie, nous les vidons de leur substance»
Ce dimanche, l’UDC va encore progresser et je ne serais même pas surpris si le seuil des 30% était franchi! Ce n’est pas ce qu’annoncent les sondages ou les spécialistes, qui eux disent que le potentiel électoral du parti est épuisé. Mais c’était le même scénario il y a quatre ans déjà. Pourquoi cette poussée? Parce que ses farouches adversaires ont été tondus comme des moutons et sont tombés dans tous les pièges tendus! Que ce soit à Lausanne ou à Berne, le même pathétique étalage de haine des soi-disant défenseurs de la démocratie, confirmant la justesse du dicton «honni soit qui mal y pense» (ou, si vous préférez la version infantile, «c’est celui qui dit qui l’est») car opposant l’intolérance et la haine à ce qu’ils croient devoir dénoncer comme haine et intolérance, favorisant le fascisme en s’imaginant le prévenir !
Qu’en a pensé notre quatrième pouvoir (le lobby journalistique autrement dit)? Bien sûr, il blâme ces extrémistes qui font le jeu du parti qu’il bannit. Mais il ne les dénonce pas vraiment non plus. Impartial comme il se doit, 50 néonazis paumés qui organisent un concert privé en Valais l’inquiète bien davantage que 500 activistes d’extrême gauche qui mettent la place Fédérale à sac! Les rouges-verts-noirs? Non, pour les coupables, on hésite entre la police et l’UDC elle-même! Franchement, quelle idée de faire une manifestation de droite! Décidément, la Suisse ne fait jamais rien comme les autres; cherchez un pays au monde où le plus grand parti ne pourrait organiser une marche électorale dans la capitale...
Drôle de pays, me disais-je d’ailleurs, en y débarquant de ma Suède natale. Ils ne connaissent ni leur hymne national, ni le nom de leur président! Et, en six ans d’études secondaires, la seule chose que j’ai appris de son histoire était l’épisode du Sonderbund. Page d’histoire qui est d’actualité, car une nouvelle ligne de fracture se profile à l’horizon si nous n’y prenons garde. Alors, j’invite tous les gentils bien-pensants à appliquer leur dogme de tolérance à la lettre, de cesser les amalgames et les procès d’intention permanents, de faire un peu de gymnastique mentale avec leur petit prêt-à-penser. A force d’abuser de mots comme racisme ou xénophobie, nous les vidons de leur substance.
Il faut reconnaître une fois pour toutes qu’il existe un malaise identitaire, perceptible et réel. Pas seulement chez nous. Voyez le virage politique chez nos voisins. En Scandinavie, ce paradis progressiste, les partis similaires à l’UDC montent en puissance, là aussi. Aux Pays-Bas, champion historique de la tolérance, le discours politique a drôlement changé depuis l’assassinat du cinéaste Theo van Gogh. Ici, depuis mon arrivée, je constate une détérioration sensible de la sécurité – et donc de la qualité de vie – liée surtout aux flux migratoires. Voilà pour planter le contexte. À partir de là, j’ai toujours été contre la haine sous toutes ses formes. Mais, pour l’instant, comme c’est le cas dans les autres pays d’ailleurs, j’observe qu’elle émane essentiellement du camp de ceux qui préconisent la fraternité universelle. L’idéologie n’a jamais fait très bon ménage avec la réalité.
© 24 Heures
Des critiques pleines d’arrière-pensées
PRESSE ÉTRANGÈRE
On peut s’étonner de lire, dans la presse internationale, les attaques contre la Suisse accusée de xénophobie, sinon de racisme. Alors qu’elle a accumulé ces trois dernières décennies cinq à dix fois plus d’étrangers et de réfugiés qu’aucun des pays où sévit cette presse.
Comme toujours, le problème est ailleurs. Les "maîtres du monde", les mondialistes sont conscients qu’un pays démocratique, où le peuple a son mot à dire dans sa conduite, n’est pas concevable dans un gouvernement global. La "démocratie" parlementaire est une nécessité pour eux.
Le peuple doit se contenter d’élire, ou plutôt de cautionner les parlementaires choisis et avancés par les partis et les lobbies. Ensuite il n’a plus rien à dire. Il est plus facile aux "maîtres du monde" de suborner une majorité des quelques centaines de parlementaires, déjà programmés, que de convaincre les millions de citoyens avec leur diversité et leur autonomie. Ce qui est absolument nécessaire dans la démocratie directe où le peuple peut remettre en cause (presque) toutes les décisions du Parlement et du gouvernement, par voie de référendum ou d’initiative.
Les mondialistes le savent et notre élite est complice. Il faut donc naturaliser le plus d’étrangers de culture politique parlementaire pour parvenir, à terme, à ce changement. Ces néo-Suisses, majoritairement ignorants de l’histoire de leur nouvelle "patrie", voteront ce changement sans états d’âme.
Ceux qui s’opposent à cette aliénation du peuple indigène sont traités de xénophobes et de racistes. La réaction de la presse internationale est donc compréhensible, puisque toute dans les mains du capital mondialiste.
Ernst Truffer,
Sierre
La vraie Suisse
CAMPAGNE DE L’UDC
Réserver la Suisse aux seuls Suisses authentiques est une entreprise dont nous ne pouvons contester la légitimité. Nous devons donc envisager l’expulsion, ou lorsque ce n’est vraiment pas possible au moins la privation des droits civiques, pour tous les étrangers (et leurs descendants) venus au cours des siècles s’installer chez nous et manger notre pain.
Pour le canton de Vaud (qui n’a été rattaché à la Suisse, sous forme de colonie – bailliage qu’en 1536, mais c’est un détail), il s’agit des ethnies ou des groupes suivants: tous les réfugiés actuels venus du monde entier, les ressortissants de l’Union européenne qui profitent de la libre circulation, les ouvriers italiens des années 1950 à 1960, les réfugiés anticommunistes tibétains (1959), hongrois (1956), ou ayant réussi à franchir le rideau de fer, les rescapés des camps de concentration, les antinazis et antifascistes et les soldats anglais et américains prisonniers évadés d’Allemagne lors de la dernière guerre, les Juifs persécutés, les indépendantistes italiens du Risorgimento, les bonapartistes, jacobins et monarchistes français selon les époques, les Réformés persécutés lors de la Révocation de l’Édit de Nantes, les Burgondes, les Romains, les Helvètes et les Tigurins, les agriculteurs du groupe de Cortaillod, et les prédateurs nomades du groupe de Cro-Magnon (à Villeneuve).
Nous nous retrouverons alors avec fierté entre nous, les seuls vrais Suisses, les Suisses authentiques, ceux qui forment le peuple suisse. Nous, les descendants directs des habitants de la Grotte de Cotencher. Des Néanderthaliens.
Daniel Monthoux,
Lausanne
Moutons blancs, mouton noir
Revenons sur ce sujet si vous le permettez, car un détail, me semble-t-il, a échappé à tout le monde.
Le mouton noir a été chassé.
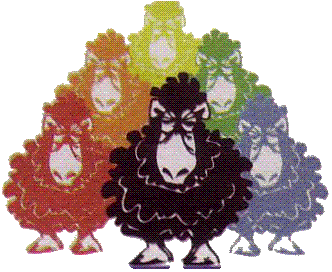 Restent donc les moutons blancs.
Restent donc les moutons blancs.
Si vous retranchez l’adjectif, il reste alors les moutons tout court, c’est-à-dire nous !
N’est-ce pas cela que désirent précisément les auteurs de cette affiche et tous ceux qui s’en rapprochent: que nous soyons des moutons bêlants, au service d’une idéologie de repli à travers laquelle ils peuvent exercer leur pouvoir ?
Sommes-nous des moutons ou des êtres humains débarrassés de la peur, capables de faire face intelligemment et avec bon sens aux défis du monde actuel, et ceci, tout en maintenant nos propres valeurs ?
Notre pays ne doit pas être un foyer d’exclusion. Quand nous excluons, nous nous trahissons nous-mêmes.
Pensons-y.
Simone Devantéry,
Moudon
FAIBLESSE COMPLÈTE !
COMMENT BLOCHER A AMOLLI PRESQUE DÉFINITIVEMENT LE GÉNIE DE LA SUISSE, ISSUE DE LA RACE DÉPLORABLE DES CAPITALISTES, TOUS MARCHANDS DE SAVON ET DE MENSONGES !
 Voici qu’est venu parmi nous prêcher le faible d’entre les faibles, le trouillard d’entre les trouillards, le sot parmi les sots, le plus dégradé moralement parmi les plus dégradés: Christoph Blocher !
Voici qu’est venu parmi nous prêcher le faible d’entre les faibles, le trouillard d’entre les trouillards, le sot parmi les sots, le plus dégradé moralement parmi les plus dégradés: Christoph Blocher !
Encore lui !
Un peuple abâtardi dans son instinct de vie, dégénéré, incapable même de Christianisme, ne pouvait qu’offrir à l’Europe le spectacle le plus piteux qui soit: un FAUX chef.
Un chef qui, par la médiocrité relâchée de ses instincts, et sa propension infinie à mentir sur la vitalité desdits instincts arrive peu à peu par la chimie politique de la propagande à inverser toutes les valeurs.
Ainsi la puissance intellectuelle est-elle devenue... l’apanage de la gauche, ces doux rêveurs, que la révolution conservatrice va associer à tout ce qui nuit à l’effort des petits nains assemblés !
Ainsi la puissance musculaire est-elle même niée devant la puissance de l’argent, qui nécessite seulement un certain sens de l’agiotage, une certaine préoccupation d’exiger de l’argent à la suite de son effort.
Ainsi la puissance spirituelle doit-elle se résigner à prier pour ceux qu’on déporte et à laisser déporter. Après tout, ce qui est l’affaire de notre volonté et de notre solidarité, n’est-ce pas l’État qui s’en occupe ?
Ainsi les vertus mêmes de la droite sont-elles amoindries: on peut désormais péter et être vulgaire, c’est de la droite! On peut faire semblant de se prosterner devant une icône: c’est de la religion. On peut faire semblant de croire à la patrie: ce semblant de copié-collé de vague fantôme suffit.
Ainsi les vertus de gauche sont-elles associées à une dégénérescence fictive: celui qui est de gauche, il perd son temps à faire la charité, il devrait claquer son argent pour lui seul, il se préoccupe inutilement du bien-être! Ha, mes frères! Voici l’évangile de Blocher: la charité commence et finit par soi-même, et chaque individu est un monde en soi! Magnifique petit monde. Il se prend lui-même pour fin et s’endort satisfait.
Voici que le patriotisme lui-même est détourné! Il suffit de brandir un drapeau suisse et voilà qu’on est Suisse! Attention: il faut pour cela être un vrai Suisse. Un vrai Suisse, c’est un faux qui bombe le torse et fait semblant d’être vrai. Un vrai Suisse, c’est un quelconque singe armé d’un drapeau suisse, qui mésuse provisoirement de son intelligence, point nécessaire.
Car le communisme retourné donne Blocher à l’évidence! Le grand grand parti récite sa messe perpétuelle à son chef. Et à son tour, le chef pense pour tous les citoyens, ce qui fait que toute vertu, toute participation patriotique ou sociale à la Suisse est inutile: Christoph pense pour nous.
Le sens traditionnel de la révolte, de la contestation contre l’étranger, qui fonda les bons Suisses, disparaît. On ne conteste plus la domination du bailli Blocher: on envoie seulement deux ou trois policiers déplacer deux ou trois mendiants, et le tour est joué.
Protester, la vertu suisse! Voilà qui est vertu à jamais endormie, car le chef pense pour nous. Il appauvrit les uns, il enrichit les autres, et tout doit tourner autour de lui: médias, petits nains, et chuchotements !
Apeurés, apeurés! Timorés! Désormais au fond de leurs petites cavernes, les Suisses se disent: chut! Es-tu sûr que le chef qui nous protège, ne nous en voudrait pas si nous protestions? Après tout, à quoi bon protester! Nous avons notre petit gâteau pour le jour et notre petit gâteau pour la nuit: oublions ce fâcheux désir de protester.
Le plus faible d’entre tous les Suisses, l’incarnation de la faiblesse morale, spirituelle, intellectuelle, enfin politique, a réussi à passer pour le courage même: voici la mascotte des Suisses réduits à leur plus simple expression, le grand génie de la vulgarité, celui qui nous tape sur l’épaule en disant : Grandeur? Surtout pas! Moi-même, je suis prudent dans la grandeur. Je me contente de compter mes sous et de penser à moi.
Le plus paresseux d’entre tous, celui qui punit les paresseux et diffuse l’image d’un homme qui travaille plus que les autres! Certes, il travaille beaucoup, et il pense moins: le travail, ce n’est pas fait pour penser !
J’ai nommé: le putsch du roi des faibles sur les forts de la Suisse, cantonnés désormais à ces poches exotiques que sont: les institutions d’entraide, les partis de gauche, les églises, les institutions culturelles, la culture à la maison, sauf là où règne une bonne ménagère.
Voici le peuple le plus fort du monde vaincu par la force la plus forte jamais déployée de sa plus intime faiblesse !
Je vous enseigne l’évangile de la médiocrité: courez au secours de votre propre médiocrité, on vous paiera assez tôt pour l’assumer, puisqu’on l’assumera à votre place.
Résignez-vous! Ne désirez jamais plus rien de grand! Abdiquez, et si vous n’êtes pas frustré, on vous enseignera l’art de la contestation modérée et feutrée, car un espace est prévu: il y a un temps pour contester, et il y a un temps pour agir – pour obéir.
Je vous enseigne l’art du silence, de la lâcheté, de la petite protestation à la petite semaine: taisez-vous! Ce sera beaucoup plus confortable, et tout ira beaucoup mieux ainsi, en allant beaucoup plus mal.
À ceux qui nous reprochent de faire la guerre à la société,
nous répondrons: la vie suppose le combat.
Nous rétablirons le combat dans l’autre sens,
c’est-à-dire la réponse des opprimés aux Détenteurs du capital,
la réponse des prétendus faibles aux mécanismes mis en place par les forts,
et la réponse du civisme solidaire à la lâcheté...
Ehpotsirhc Z. Reyem
plus social-démocate que jamais
espérant la chute prochaine du précédemment nommé,
espoir dans l’ordre du raisonnable
Blocher est parti mais son avatar qui le remplace est encore pire !
Pour preuve, ces quelques citations tirées de son livre «Ma maison, ma Suisse», où Maurer a détaillé quelques-unes de ses idées politiques :
On peut y lire que, entre autre :
- «Je trouve faux qu’une femme travaille et que l’État doive s’occuper de ses enfants. C’est le déclin de notre société !»...
- «l’assurance-invalidité est un tonneau sans fond»...
- «les femmes et la protection de l’environnement n’engendrent que des coûts»...
De plus on apprend...:
- qu’il est résolument opposé à l’avortement, au partenariat enregistré et à l’euthanasie,
- qu’il s’élève contre l’harmonisation des allocations familiales et, par conséquence, il est contre la «participation de l’État aux crèche»,
- que la politique d’aide au développement de la Suisse, pourtant si faible, «est beaucoup trop chère»,
- que la gauche «tend ses doigts crochus» vers l’argent des Suisses, et «représente les profiteurs de l’État, les abuseurs sociaux».
Lui qui qualifiait il y a peu Eveline Widmer-Schlumpf, sa désormais nouvelle collègue, «d’appendice qui doit être éliminé», et le système de concordance de «lupanar douillet», accède maintenant au Conseil fédéral. Certains observateurs y ont vu un retour de «l’aile dure» de l’UDC au gouvernement. Ce serait considérer Eveline Widmer-Schlumpf comme une «modérée». Or «l’appendice» prépare un durcissement des conditions d’asile, sous-entendant que son prédécesseur Blocher se serait montré trop laxiste sur le sujet !!
Ce n’est que par pure coïncidence que cet homme a été élu au Conseil fédéral le jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme !
Dans cette drôle d’Helvétie qui va à vau l’eau depuis que Blocher est là pour la conforter dans son marasme, le vampire chauve de l’udéssé vient en prime comme carte de visite internationale, même s’il n’est plus possible de cacher l’indécence et le ridicule.
 On n’est vraiment pas gâté par notre Conseil fédéral! Qui peut se souvenir d’une galerie aussi piteuse que celle qui est élue actuellement? On peut partager le désappointement de Zysiadis après cette élection qui n’en fut pas une. On vit vraiment un noir tunnel. Outre que ce Maurer n’a aucune envergure d’homme d’État visionnaire et de citoyen dévoué, il n’est qu’un vil propagandiste, comparable, toutes proportions gardées, à ce que fut un Julius Streicher pour les nazis. Dire que la Suisse n’avait pas le choix... cela fait rire, tout simplement. Bien sûr qu’on pouvait élire cet autre bonhomme UDCiste, ce Hansjoerg Walther, c’était au moins une nuance de gris en moins dans le pire. Là... le parlement a péché par indulgence. Trop d’indulgence amène des erreurs électorales comme celle-ci.
On n’est vraiment pas gâté par notre Conseil fédéral! Qui peut se souvenir d’une galerie aussi piteuse que celle qui est élue actuellement? On peut partager le désappointement de Zysiadis après cette élection qui n’en fut pas une. On vit vraiment un noir tunnel. Outre que ce Maurer n’a aucune envergure d’homme d’État visionnaire et de citoyen dévoué, il n’est qu’un vil propagandiste, comparable, toutes proportions gardées, à ce que fut un Julius Streicher pour les nazis. Dire que la Suisse n’avait pas le choix... cela fait rire, tout simplement. Bien sûr qu’on pouvait élire cet autre bonhomme UDCiste, ce Hansjoerg Walther, c’était au moins une nuance de gris en moins dans le pire. Là... le parlement a péché par indulgence. Trop d’indulgence amène des erreurs électorales comme celle-ci.
On peut se consoler en se disant que les autres Conseillers fédéraux ne sont pas beaucoup mieux. Mais là, c’est vraiment trop, on ne sait plus que penser. Quelle complaisance à vouloir afficher une telle galerie de caricatures !
Il y a aussi cette clause d’exclusion, prévue par l’udéssé pour tout candidat qui se présente contre le candidat officiel. C’est un peu fort, non? Cela rappelle les grandes heures du parti communiste d’Union Soviétique. Cela montre à quel point ils sont fanatiques, comme dit Suzette Sandoz, et dans des temps de malheur social, être gouvernés par des gens qui écrivent ce qui a été cité ci-dessus, c’est être à bien mauvaise enseigne.
Tout ce qui peut consoler, c’est de se dire: ce sera la dernière fois que la Suisse mettra les pieds dans le bourbier aussi profondément. Après, elle sera peut-être fatiguée de séjourner dans le bourbier et de s’y vautrer narcissiquement. Espérons que Widmer-Schlumpf et ce petit chauve soient nos dernières images de
ce que nous avons connu de pire, après quoi... Après quoi, le PS et les Verts pourront partir à l’assaut du Conseil fédéral, et cela ira mieux !
La démagogie est un instrument de conquête, mais après la conquête, s’il n’y a eu que démagogie, tout s’en va !
Et tant mieux.
Qu’ils s’en aillent mais vite !
Nous devons être d’accord: tant qu’il y aura majorité de droite, la Suisse ira mal.
Surtout, par le temps actuel.
C’est que... Voter un parti qui joue la politique du pire, ce que Neyrinck a bien démontré, et qui stimule le ressentiment des gens tout en aggravant la situation sociale, et dirige ce ressentiment vers des cibles faciles et populistes à travers sa propagande raciste – voter un tel parti, c’est vouloir sombrer.
Il n’y manque pas: la Suisse sombre socialement. Le reste est sans importance. C’est à la culture et à la qualité de vie sociale qu’on sonde un pays: alors là...
Que l’on revienne la culture et solidarité: on verra après !
Réjouissons-nous simplement de voir partir ces gens! De leur future défaite électorale! Avant cela, rien d’autre à faire que de patienter, et de faire, mais moins que ce qu’on aimerait.
Vive un peu plus d’humanité et de tolérance !
Vive la fin du mépris. Il faut garder cet espoir eschatologique, malgré ce qu’est la nature humaine, sinon on restera dans le jargon droitier consistant à dire que tout est bien comme tout est et qu’il ne faut surtout rien changer, etc. au nom de je ne sais quelle prétendue lucidité – le conservatisme est une attitude, pas une lucidité.
CAM-GPT - le 10 Décembre 2008 - l’élection d’un Conseiller fédéral UDC pure souche
Ne nous laissons pas faire !
Action directe populaire et auto-organisation !
Lutte sociale contre l’asservissement !
Socialisme et liberté !

compilé par Georges Tafelmacher
LIENS
 - Qu’est-ce que le libéralisme ?
- Qu’est-ce que le libéralisme ?
l’avertissement poignant de Yuval Harari à Davos -
La technologie risque de diviser le monde en deux catégories : les élites riches et les «colonies de données»
Populisme et Néolibéralisme - «Les deux faces d’une même pièce»
 - Site udc
- Site udc
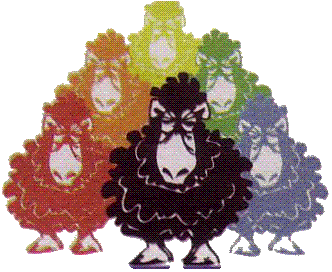 - United Black Sheep
- United Black Sheep
 - Moutons de garde
- Moutons de garde
Dossiers préparés par ©Georges Tafelmacher & SuisseForum
DATE DE CRÉATION : 27.12.2020 - DERNIÈRE MODIFICATION : 31.01.2021
par: Georges Tafelmacher Copyleft © 2020 TAFELMACHER-GEORGES.COM
All Rights to serve.